Les droits reproductifs des femmes : Une histoire complète
Lorsque nous entendons les mots "droits reproductifs", notre esprit pense souvent à l’avortement, étant donné la place de ce sujet dans les débats politiques actuels. Cependant, les droits reproductifs des femmes vont bien au-delà de l’avortement : ils incluent le droit légal à la contraception, aux traitements de fertilité, aux soins de santé reproductive, à l’accès à l’information et aux ressources, et, bien sûr, à l’avortement. En somme, les droits reproductifs assurent la liberté d’une femme de décider si elle souhaite ou non être enceinte.
Présenté ainsi, cela semble assez raisonnable, n’est-ce pas ? Pourtant, à un certain moment, les droits reproductifs des femmes ont été transformés par des agendas politiques et l’influence des croyances religieuses, devenant aujourd'hui un sujet de division. Jetons un coup d'œil à l'histoire des droits reproductifs des femmes en Amérique, en remontant aussi loin que possible.
L’Antiquité
Oui, lorsque nous disons que nous remontons loin, nous voulons dire très loin, jusqu’aux premières civilisations occidentales. Dans l’Égypte, la Grèce, puis Rome antique, la contraception faisait déjà partie des pratiques sexuelles. En fait, durant la majeure partie de l’histoire, la "contraception" incluait aussi bien les méthodes de prévention de la grossesse que l’avortement, souvent pratiqué par des sages-femmes.
Les préservatifs étaient fabriqués à partir de vessies ou d’intestins d’animaux et de poissons, et des spermicides étaient obtenus en mélangeant des excréments de crocodile et de la pâte fermentée. En 1525 avant notre ère, les Égyptiens utilisaient un mélange de miel, de feuilles d’acacia et de bouse de crocodile pour éviter la grossesse.
Le plus ancien témoignage de l’avortement se trouve dans le Papyrus Ebers, datant de 1600 avant notre ère, qui décrit une méthode où "la femme se débarrasse de ce qui a été conçu au premier, deuxième ou troisième stade." Plus tard, en Grèce puis à Rome, l’avortement était largement accepté (bien que peu fréquent) pour des raisons de contrôle familial ou de prévention de la prise de poids liée à la grossesse.
Le Moyen Âge
Ce n’est qu’au Moyen Âge que les droits reproductifs ont commencé à devenir politiques—et plus précisément religieux. À cette époque, le catholicisme est devenu la religion dominante en Occident, entraînant de nouvelles lois sur la capacité des femmes à gérer leur santé reproductive. L’Église a interdit à la fois la contraception et l’avortement, associant ces pratiques à des croyances païennes et hérétiques. Cependant, cela n’a pas complètement empêché les femmes de prendre en charge leur santé reproductive : le retrait et certaines herbes insérées dans le vagin étaient utilisés comme méthodes de contrôle des naissances. Les avortements avaient encore lieu, sous forme de concoctions herbacées visant à provoquer une fausse couche. Bien sûr, si vous étiez sage-femme et que vous administriez de telles pratiques, vous risquiez d'être accusée de sorcellerie.
Les années 1800
Oui, nous venons de sauter 400 ans dans l’histoire car, durant cette période, la situation législative des droits reproductifs est restée essentiellement la même en Occident. En gros, l’Église s’opposait à la contraception et à l’avortement, bien qu’ils ne soient pas illégaux. Aux États-Unis, l’avortement était non seulement légal, mais aussi une procédure sûre, acceptée et courante dans l’Amérique coloniale. Les avortements étaient généralement pratiqués par des sages-femmes, parfois par des médecins, avec des remèdes à base de plantes ; les interventions chirurgicales étaient rares et dangereuses.
Ce n’est qu’en 1821 que la première loi concernant l’avortement et la contraception a été promulguée aux États-Unis. C’est là que les choses ont commencé à devenir étranges.
Histoire des droits reproductifs des femmes en Amérique
- 1821 : Le Connecticut adopte une loi interdisant l’avortement médical après le stade de la "première animation" (détection des mouvements fœtaux, vers quatre ou cinq mois).
- 1857 : L’Association médicale américaine mène une campagne pour interdire l’avortement aux États-Unis. Contexte important : de 1837 à 1901, l’ère victorienne, marquée par un conservatisme extrême.
- 1873 : Le Congrès adopte la loi Comstock, interdisant la distribution de contraceptifs ou d’informations sur l’avortement par courrier. Rapidement, 24 États adoptent des lois restrictives similaires.
- 1880 : Tous les États ont des lois limitant l’avortement, avec des exceptions médicales dans certains cas.
- 1910 : À la fin de l’ère victorienne, l’avortement devient complètement illégal dans tous les États, accompagné d’un stigmate intense contre les femmes y ayant recours. Les méthodes contraceptives sont également illégales, sauf pour raisons médicales.
- 1916 : Margaret Sanger ouvre la première clinique de planning familial à Brooklyn, mais est arrêtée neuf jours plus tard. Elle fonde par la suite le Bureau de recherche clinique sur le contrôle des naissances, qui fusionnera pour former Planned Parenthood.
- 1930s : La Grande Dépression pousse les entreprises à vendre des produits contraceptifs sous le nom de "produits d’hygiène féminine", bien que certains soient dangereux.
- 1936 : Un amendement aux lois Comstock autorise les médecins à envoyer des contraceptifs par courrier, grâce au travail de Sanger en coulisses.
- 1960 : La première pilule contraceptive approuvée par la FDA est commercialisée, mais uniquement pour les femmes mariées.
- 1965 : Griswold contre Connecticut empêche les États d’interdire la contraception aux couples mariés, ouvrant la voie à une légalisation plus large.
- 1973 : La décision Roe v. Wade protège le droit à l’avortement dans les 50 États, établissant un précédent juridique.
- 1976 : L’amendement Hyde interdit à Medicaid de financer l’avortement, limitant l’accès pour les personnes à faible revenu.
- 1992 : La Cour suprême confirme le droit à l’avortement, mais permet aux États de mettre en place leurs propres réglementations.
- 2000s : Expansions de la santé reproductive, notamment avec l’approbation de la contraception d’urgence (Plan B).
- 2010 : L’Affordable Care Act permet la couverture contraceptive par l’assurance.
En 2021, le Texas instaure une interdiction quasi totale de l’avortement, suivie de la révocation de Roe v. Wade en 2022. Depuis, 14 États ont rendu l’avortement illégal. Néanmoins, la contraception reste largement accessible, et en 2023, la FDA approuve la première pilule contraceptive en vente libre, Opill.
L’avenir des droits reproductifs aux États-Unis est incertain et, pour beaucoup, les élections à venir en détermineront la direction.
Note sur le sexe et le genre : Sexe et genre existent sur des spectres ; cet article utilise les termes “homme” ou “femme” pour faire référence au sexe assigné à la naissance.
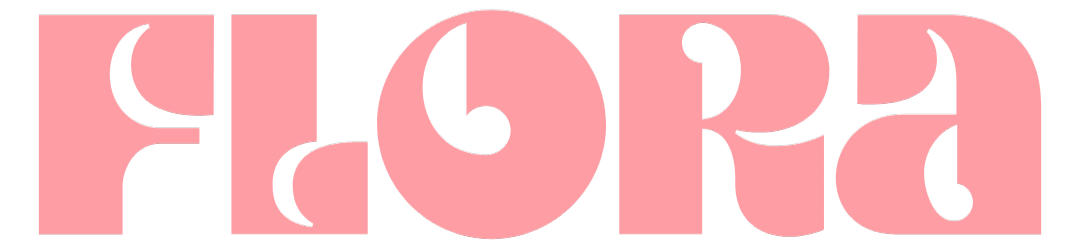


 COMMANDER MAINTENANT
COMMANDER MAINTENANT


